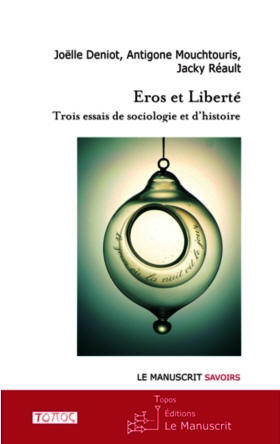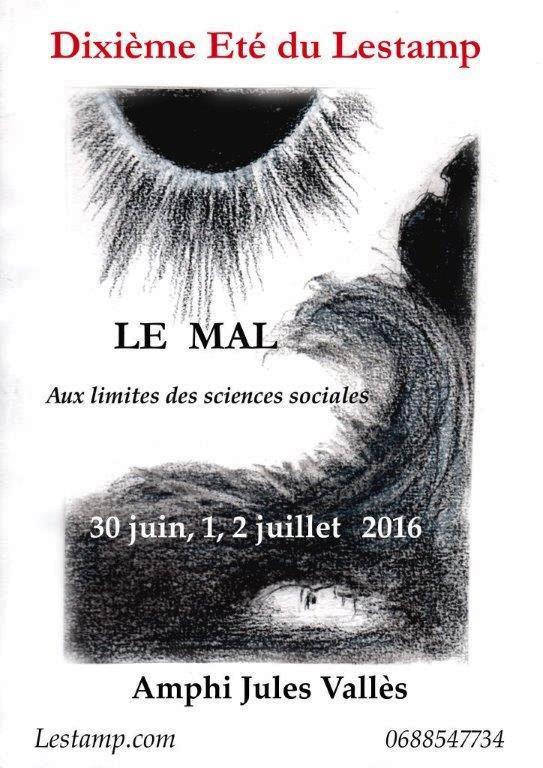|
Nantes bobo-municipal
dégoulinant de vertu-spectacle politiquement correcte à
Noël 2017
Economie de l’art et (mondialisation) des biens
culturels 2007-8
Cours de M2
Créé en 2005 pour le Master EPIC, Expertise des
Professions et Institutions de la Culture,
par
Jacky
Réault
agrégé d’Histoire, maître de
conférences en sociologie, co-fondateur du Master.

 Voeux
du LESTAMP pour
2018 Voeux
du LESTAMP pour
2018
COURS
créé par Jacky Réault, agrégé d'Histoire, pour le Master
EPIC de Joëlle DENIOT (2004-2017)
I-
Problématique et
plan général
du cours[1]
I- Qu’indique l’institutionnalisation européenne
d’un ainsi nommé secteur culturel et créatif
commun aux
financiers aux mécènes comme aux notables politiques
décentralisés, sur la connaissance possible d’une (?) économie
artistique et culturelle, complexe, hétérogène
aux frontières floues, si mêlée aux media, au
showbiz, au divertissement, au tourisme, à la
mode, et qu’on laissera problématiquement ouverte à
l’heuristique de divers questionnements ?
II-1 ceux des grands partages théoriques et classiques
de l’économique (production, consommation,
division du travail, marchandises, marchés, emploi,
rapports sociaux, imbriqués à l’Etat d’une
classe culturelle), qu’on appliquera à une approche
de description statistique
de l’économie culturelle dans le cadre français
et à la singularité, doublement fiduciaire des
« marchés de l’art ».
II-2 ceux de la stratification braudélienne de
l’économique (entre temps long et conjoncture),
(y compris culturel) en trois niveaux : - la vie
matérielle des pratiques d’appropriation et de
défense, (non marchandes privées autonomes ou publiques)
de la reproduction culturelle, - l’économie marchande, -
l’économie du capitalisme mondial… voire en prime le
risque systémique rampant, août 2007)
II-3 Ceux des économies-mondes capitalistes politiques
et culturelles des villes- ou nations-centres et
de leurs périphéries, des actuels emboîtements de
territoires : Entre la mondialisation (relative)
par les réseaux généralisés des TIC et des financiers,
des Big Ten multimédia, du globish et de
la superpuissance américaine, et l’ambivalence des
localismes et régionalismes, les civilisations, les
Etats-nations, (et quelles autres forces sociales ?),
résistent ou pas. La conjoncture générale (mais qu’en
est-il pour l’économie culturelle, et le butoir des
langues ?), c’est la Chine et l’Inde surgissant aux
premiers rangs, la Russie qui revient, le vouloir
vivre d’une France en reclassements où se
redéfinissent les frontières politiques et l’Etat
culturel, sur fond expansionniste défensif et
prédateur américain, déflationniste dans le cadre
récessif de la monnaie unique d’une Europe de rentiers.
II-4 ceux du clivage binaire que l’on re-pondère, de
Walter Benjamin autour de la (non)reproductibilité :
. 41) La qualité d’œuvres non reproductibles, de
performances d’artistes dans l’instant du spectacle rest(ai)ent
peu menacées par l’économie, - marchande ou d’Etat-,
du singulier :
l’art, (artistes, galeries, enchères
publiques, musées), la patrimonialisation d’Etat, les
spectacles (théâtre danse cirque mime), les
festivités populaires esthétisées. Jusqu’à la pandémie
actuelle des festivals ?
42) L’ère de la
reproductibilité sérielle et industrielle,
des media et biens culturels de masse, (Ecole de
Francfort ou G. Debord), la conjonction
technologique capitaliste et spectaculaire n’avait pas
empêché une économie sectorisée viable et encore
signifiante (cinéma, disque, édition…).
43) Sa mondialisation se lit (entre la nouveauté
du capitalisme culturel valorisant le temps de
cerveau humain disponible, et le nihilisme d’Etat
dans l’art contemporain pour les classes parlantes),
comme dé-symbolisation
et dés-institutionnalisation niveleuses (G. Bois) ou
réappropriations populaires encore possibles des
mediacultures (E Maigret) ?
III- Où trouverait refuge l’utopie ( ?) d’une Valeur
réunifiée par l’héritage culturel républicain des
familles de l’école, de l’éducation populaire :
Entre l’Etat (du 1 %) culturel, central ou
décentralisé, son art officiel voire
clientéliste (Hystérisation du cas nantais ?), sa culture marchandisée, l’alibi patrimonial, ( et la libre entreprise culturelle qui
pourrait davantage attirer les artistes authentiques pas
toujours happés par les « oligopoles à frange » ? Mais
ou poser ailleurs que dans le politique la question la
plus difficile d’une économie de la culture non
asservie, celle des besoins culturels ?
·
La fiduciarisation intégrale des grands marchés
de l’art, ( Jacky Réault Eté du Lestamp Nantes 2007)
faisant de l’œuvre (ou de la pièce en termes
« contemporain », le support de prix spéculatifs
illimités. Le record mondial de 50 millions de dollars
vient d’être atteint en avril 2008), est-il en train de
tuer de l’art d’autant plus qu’il en inverse
(provisoirement ?) les « valeurs") .
·
J Réault mai 2008
(copyright)
Bibliographie d’orientation
Fr Benhamou,
L’économie de la culture. La Découverte 2004.
Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa
reproductibilité technique. Réed. Paris Ed. Allia
2006.
G. Bois,
Une nouvelle servitude, essai sur la mondialisation.
François-Xavier de Guibert 2003
F. Braudel,
La dynamique du capitalisme. Aubier 1984
Philippe Coulangeon,
Sociologie des pratiques culturelles La Découverte 2005.
(Une approche des consommations par un regard
sociologique très (trop marqué) dans une seule
problématique, mais utile en compléments des données
INSEE.
M. Dagnaud
Les artisans de l’imaginaire. Comment la télévision
fabrique la culture de masse.
A Colin 2006
D Duclos
Naissance de l’hyperbourgeoisie,
Monde Diplomatique Aôut 1999
X. Dupuis et Fr. Rouet,
Economie et culture Les outils de l économiste
à l’épreuve.
Documentation
Française 1987
J. Gabszewicz et Nathalie Sonnac,
L’industrie des media.La découverte 2006
Y. Galliard,
Rapport d’information fait au nom de la commission
des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la Nation sur les aspects fiscaux
et
budgétaires d'une politique de relance du marché
de l'art en France, 29/04/99.
J. Guibert,
La production de la culture, le cas des musiques
amplifiées en France. Irma Edi. 2006 (Edition de la
thèse, Dir.J. Deniot)
I. Garat P.Pottier, Th. Guinebreteau, V. Jousseaume, F.
Madoré.
Nantes de la belle endormie au nouvel Eden de l’Ouest.
Economica-Anthropos 2005, chapitre V « Images et
cultures nantaises ».
Insee-Ined,
Tableaux de l’économie française 2007.
G. Olivennes,
La gratuité c’est le vol.
Grasset 2006
M. de Saint-Pulgent, P Benghozi,
T. Paris Réactions et réponses à la mondialisation
IFRI Document.
française diffusion (mai 2003)
E. Todd,
L’illusion économique essai sur la stagnation des
sociétés développées.
Gallimard1998(
C’est dans ce livre qu’est découverte l’existence d’une
classe culturelle « classe culturelle »
plutôt désolidarisées des classes populaires et de la
solidarité nationale et évidemment née avec le Langisme
. Depuis ce livre (1998) elle paraît épisodiquement en
voie de décomposition lorsque des conjonctures
politiques (referendum européens, présidentielles) re-polarisent
le corps politique français entre oligarchies
mondialisées classes populaires et peuple politique
résistant (nation). L’obsolescence morale d’une partie
de la culture d’Etat contemporaine (théâtre arts
plastique etc. aide épisodiquement)
-
Compléments sur l’économie
de l’art,
-
Le manuel de Fr Benhamou est nécessaire mais trop
sommaire (voir nos notes critiques in fine) et surtout
clos dans le "donné" a problématique de l'Etat culturel,
y compris européen.
-Le rapport au Sénat
Judith Benhamou-Huet. Art business-2. Assouline/2007
-
Lise Cormery,
L’art en France de 1959 à 2000 (un survol très
empiriste mais très authentique d’un témoin, à partir
d’une situation professionnelle singulière, mais un
regard vigoureux n’excluant pas des facilités)
La revue l’œil et la Gazette de l’Hôtel Drouot,
Les articles de l’Expansion, notamment celui de Jean
Clair Le temps de l’art n’est pas celui du spéculateur
(distribué)
-sur les « industries culturelles »
Revue Problèmes économiques. Les industries culturelles
face au défit de la gratuité.
La
Documentation française 16 janvier 2008-
(D’utiles débats
relativement contradictoires dans une revue par ailleurs
très officielle).
____________________________________
Introduction générale[2]
NB il s'agit de
notes brutes non revues éditées telles quelles ce 14
juin 2014. Elles seront lissées et complétées dans
un proche avenir.
N'hésitez pas
à vous adresser à
jacky.reault@wanadoo.fr
Exposé des motifs
Dans la conjoncture d’une mondialisation pensée comme
processus et comme politiques en aucune façon comme un
état stationnaire adjugé[3],
A replacer
dans une histoire du temps long des
économies-mondes jusqu’à la mondialisation (Entre 1974
et 1984 ?) d’autant plus que leurs centres sont les
principales matrices de l’art et de la culture. Document
distribué mais non commenté J Réault Cycles et
succession des économies-mondes du capitalisme
historique (Tableau)
..dont les dimensions sont
-géopolitiques, (centre politique économique
culturel, aire anglo-saxonne) dé bipolarisation re
polarisation violente, naissance de puissances)
-technologiques,
-financières,
Conjoncture mouvante des Big Ten[4]
(majors financiers multimédia), Ne pas
fétichiser évidemment ce nombre de dix signifiant
commode mais non arithmétique. Les tableaux panoptiques
des dix principaux groupes financiers mondiaux
maîtres des media et des industries culturelles,
disponibles sur le web, sont distribués en cours avec un
texte chapeau synthétique (le tout en anglais)
Conjoncture des réseaux généralisés, des EU puissance
centrale d’où émanent des guerres dissymétriques en
séries rapprochées,
Conjoncture d’un monde anglophone dont la langue tend à
devenir contrainte universelle
, d’Etats et territoires résistants ou pas,
Conjoncture enfin d’’une crise généralisée des formes
démocratiques notamment sur les rapports des media de
l’économie et de la politique et de la légitimité des
oligarchies qu’apparaissent les tenants (Poulantzas) de
l’Etat culturel central et décentralisé (le plus
concrétement pesant !).
D’un désarroi face aux régulations possibles du rapport
entre la mise en réseau ouvert par les techniques la
diffusion et la rétribution des œuvres (droit d’auteur),
crise désormais au centre de l’économie de la culture
(Loi Davsi), comme l’est celle d’un emploi qui cumule en
France l’artificialité des protections et subventions et
l’incrustation dans le capitalisme culturel le plus
cynique. (Crise des Intermittents du spectacle)
Dans une société qui reste la 5° puissance économique du
monde et dont seule en Europe la dynamique démographique
est maintenue
Où cependant le doute règne sur un avenir notamment
culturel (l’exception) et linguistique (francophonie loi
Toubon) mais aussi politique
Et où la scission est radicale entre des oligarchies
régnantes y compris culturelles et médiatiques et la
majorité de la population qui rompt avec les classes
parlantes à chaque élection depuis 25 ans avec un sommet
lors des dernières présidentielles et du dernier
referendum européen
On tente une analyse
théorique descriptive et sociographique,
(Tableaux de l’économie française. Insee complétée par
les bilans culturels de début d’années et le suivi de la
Presse., intégrée à la Biblio minimale comme les
suivis de presse de l’actualité dite culturelle (entre
mondialisation économie et Etat) à travers[5].
De la production
du travail et de la division du travail de l’emploi et
de la division de l’emploi, donc de l’échange et de la
distribution, des marchés et de ce qu’y signifient et
représentent l’offre et la demande, de l’économie non
marchande, de la consommation… et concept par trop
évacué depuis 20 ans par l’Etat culturel et ses classes
ou idéologisé par les sciences sociales, DES BESOINS,
concept d’une audace devenue impensable par les
féodalités de l’Etat culturel.
:
Assez parler de moyens ou des échecs de la
« démocratisation » quid des besoins[6]…
Outre les nomenclatures des chapitres de Fr. Benhamou,
se référer aux chiffres actualisés des
Tableaux de l’économie française (TEF de l’INSEE)
de la dernière année disponible, distribués en cours
avec leurs commentaires officiels et au chapitre II de
Jean-Michel DIJAN, Politique culturelle la fin d’un
mythe. Folio 2005.
, des forces sociales et classes culturelles ( ?)
des rapports sociaux imbriqués de l’Etat et du
capitalisme culturels?
(Vr G Bois, G
Salmon, et D Duclos op. cit infra.)
On entend par Capitalisme culturel
En premier repérage le pouvoir désormais exercé
directement des groupes financiers transnationaux
(quoique toujours à
base diversement nationale, pour autant que les
Etats nations résistent eux-mêmes très inégalement à
leur prédation rampante par la mondialisation) sur les
centres de production et de diffusion de l’information
(media) sur les industries culturelles, sur l’emploi
culturel et tendanciellement sur le PATRIMOINE PUBLIC
NOUVELLE MINE D’Or de la valorisation (l’exemple
du Louvre à Abou Dabi)
1°) La pensée latente et explicitement relayée par les
classes parlantes, d’une mondialisation achevable à la
fois nivellement et ethnicisation différentialiste,
pensée de la désymbolisation et désinstitutionnalisation
(tout, dont le corps le sexe la culture est marchandise)
En termes plus
réalistes,
2°) La captation de la part de la plus-value des autres
secteurs qui passe par
une productivité spécifique à incruster leur
publicité
pas seulement dans le temps absolu manifeste
empiriquement décelable (désormais grâce à l’Europe 17 %
du temps total des media audio-visuels)
3°) Mais par l’adéquation des programmes à une
mobilisation des cerveaux ciblée moins sur eux-mêmes que
sur le temps publicitaire Des produits culturels qui
déblaient les cerveaux humains solvables pour augmenter
la rentabilité de la publicité pour les annonceurs dont
son prix.
4°) La production directe et vente par les industries
culturelles de produits livres, disques, films,
logiciels, jeux vidéo finalisés comme n’importe quelle
autre industrie sur la production de survaleur sachant
qu’ici elle est à la fois plus aléatoire et quand elle
donne plus juteuse. Produits matériels produits
matériels, captation par les producteurs des droits
d’auteur etc. ; USA J Hallyday)
La mise en place de dispositifs de production des forces
de travail elles-mêmes chanteurs artistes totalement
formatés (et pourtant contradictoire ex M Mathieu
chanteuse populaire quand même malgré J Stark) ex la
Star Ac, reality shows)
4°) La captation indirecte des profits induits par ces
produits par les achats de machines médiatrices de
consommation à obsolescence morale et physique rapide
cyniquement programmées lecteurs de disques cd vidéos
captation de MP3 consoles de jeux postes de télévision)
5°) La valorisation par produits dérivés ou simplement
produits tout cours des rassemblements de multitudes
MARCHES IMMEDIATS valorisables et cédules : Voir
l’apologie nantaise « de gauche » des zéniths.
_______________________
La question de
L’extension empirique
Que
mettre et ne pas mettre dans les « industries
culturelles » ?
La réponse de Benhamou des secteurs
spécifiques certes existants et évidemment l’univers des
media.
D’autres réponses
Quid des media
totalement imbriqués ?
Du tourisme des industries de luxe, hétérogènes
L’exemple des jeux vidéo. Outre mes sédiments l’article
pris sur le site BU Université de Nantes sur le virtuel
en général et sans doute emprunté au CNRS. In secteur
Jeux vidéo…
Cette économie culturelle si mêlée à celle
des media, du divertissement, du showbiz
des groupes financiers, ne peut que rester
problématique n’étant adjugeable ni
dans l’a priori ni dans l’empirie. Ceci est évidemment
en rupture avec qui croit qu’on peut trouver une
« économie de la culture » univoque comme le nez au
milieu de la figure. (« économistes » et « politiques ».
Comment parler dans l’homogène et les frontières claires
de l’imbrication de la culture spécifiée à l’univers
financiaro-médiatique, dans l’indécidabilité des
pratiques que dénote l’industrie ( ?) touristique.
L’univers économique appréhendé est partout marqué, -
mais jusqu’à quel point ? -, par d’inachevables ( ?)
dédifférenciations : entre la technique et la
culture dans le multimédia, le téléphone, les
jeux vidéo, entre biens ou performances culturels et
marchandises, entre art et produit entre culture et
divertissement, entre pratiques et consommation[7],
entre centre américain et sociétés dépaysées,
acculturées, entre Etat (central, régional,
municipal[8])
et marché[9].
AVERTISSEMENT
aux notes de
lecture
DE
LECTURE
De Fr Benhamou par J Réault.
A titre strictement indicatif nous donnons ici nos notes
(non élaborées pour l’édition) d’une lecture critique du
livre de Françoise Benhamou, l’économie de la culture.
Ce positionnement propre à la logique d’un cours n’est
en aucune façon un résumé fidèle des richesses de ce
petit manuel et ne dispense pas de sa lecture
obligatoire et requise pour la validation.
Ces notes ne
sont livrées que pour aider à saisir les articulations
césures voire failles d’un livre confronté à d’autres et
à un savoir plus généralisant.
Le grossissement majuscule est la marque d’un texte fait
pour la lecture orale lors d’un cours. On n’a pas
reformaté ces notes qui sont faites pour aider non pour
publication. Elles n'en constituent pas moins un propos
original à diffusion interdite sans référence à ce site
et à l'auteur.
ECONOMIE DE LA CULTURE
Benhamou,
Françoise. L'Économie de la culture[10]
Imbrication étroite entre économie et culture
Remarquable essai, Françoise Benhamou clair et
synthétique pour lecteur averti et néophyte : ensemble
des secteurs qui ressortissent
ordinairement au champ de la culture,à
l'exception de l'économie des média,(voir Jean Gabszewicz et Nathalie Sonnac), L’industrie
des media pourtant considérée par elle comme
organiqement liée aux autres..secteurs et pratiques.
TROIS
CRITIQUES DE FOND.
1°)
NE PAS DEBATTRE DES QUESTIONS AUXQUELLES REPOND L’ORDRE
D’EXPOSITION IMPORTANT MESSAGE AVEC LA CONSOMMATION AU
DEBUT LES POLITIQUES CULTURELLES À LA FIN
2°)
SE RESOUDRE À L’ENUMERATION ANALYTIQUE SANS
ANALYSER L’ORGANICITE CROISSANTE QU’INDUISENT LES
PRIVATISATIONS, LES CONCENTRATIONS, LES REVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES ET LE MULTIMEDIA (MEDIA PAS ETUDIES) ET
PLUS GLOBALEMENT
... comme principe d'intelligibilité,
LA MONDIALISATION
QU’IL EST
DANGEREUX DE REDUIRE COMME LE FAIT LE
LIVRE À UN ATTRIBUT DES INDUSTRIES CULTURELLES ALORS QUE
C’EST UN PHENOMENE GLOBAL ÉCONOMIQUE ET
CIVILISATIONNELLE REVOLUTIONNANT TOUTE LES PRODUCTIONS
ET PRATIQUES CULTURELLES HUMAINES… (Guy Bois),
3°) ...et les RESISTANCES de nations, de
cultures, de classes, de civilisations de religions qui
pèsent dans un autre sens dans la singularité d'une
histoire ouverte irréductible à la pensée fantoche de
l'évolution.
Plan Plus pédagoqique que fondé théoriquement (jr)
I-
Début par CE QUE NOUS QUALIFIONS DE GRANDES
TRANSVERSALITES.–
1°)la consommation
La consommation culturelle
C'est
par la « consommation » culturelle que commence F. Benhamou
Comment
expliquer sa faible croissance
attestée par de nombreuses enquêtes alors même que le
revenu augmente ?
Plusieurs hypothèses tentent de rendre compte de ce
phénomène.
1°) hypothèse - dite de la reproduction : l'inégale
répartition du capital culturel.
Bourdieu : le poids de l'apprentissage familial,
prolongé et consolidé par l'école, détermine la
reproduction des comportements culturels.
-les
enquêtes du ministère de la Culture sur les
pratiques culturelles des Français[11],
-l'amour de l'art
[12]
l'inclination à fréquenter les lieux et les oeuvres de
culture dépendent largement de l'héritage
culturel transmis au sein de la famille :
l'essor de
la diffusion de l'offre culturelle n'a pas
entraîné une profonde démocratisation de l'accès à la
culture.
La même théorie est au coeur des théories économiques
de la consommation culturelle élaborées aux États-Unis
depuis l'étude de la Ford Foundation sur la
fréquentation des spectacles de ballets (1974),
démontrant que
le niveau de diplôme, quelle que soit la position sur
l'échelle des revenus, prévaut toujours sur celui du
revenu.
---Mais le niveau de diplôme n’est pas dit jr uniquement
déductible de l’héritage familial…Autonomie relative.
2°) F Benhamou admet que l’hypothèse de la reproduction
(bourdivine) est
fortement critiquée en France depuis quelques années.
Certes d'autres hypothèses, émanant de chercheurs américains,
sont également passées en revue, mais leur dessein commun est d'appliquer au secteur culturel
les postulats les plus orthodoxes de l'analyse économique.
On y retrouve les grands courants de cette discipline,
depuis les néoclassiques et les marginalistes marqués
par un déterminisme excessif jusqu'aux travaux les plus
récents.
Certains
prennent en compte l'importance des phénomènes de
substitution comme variable du niveau de
consommation culturelle à partir du constat que le
public des profanes, peu initié au théâtre, préfère les
spectacles qu'il juge les moins risqués, tandis que
d'autres appliquent au domaine des biens culturels la
théorie de Kelvin Lancaster (1966), selon laquelle
l'utilité d'un bien dérive de ses propriétés
spécifiques.
Ainsi, David Throsby (1990) s'attache à recenser les
composantes esthétiques qui constituent le jugement sur
la qualité d'une oeuvre
3°)
et l’emploi
-
MAIS cela
fait l’économie d’un débat sur le primat de l’offre sur
celui de la demande qui privilégie le sociologisme
surtout bourdivin..
L'emploi culturel[13]
L'attention est également attirée sur l'importance de
l'emploi culturel,
Difficultés d'évaluation, compte tenu de l'imprécision
des sources.
Depuis le
dernier recensement (1990),
l'effectif des professions artistiques
(283 163 personnes en 1994
selon l'insee/dep)
AUGMENTATION :
accru de 37 %, surtout dans le spectacle et
l'audiovisuel, (JR détermination spécifique de
l’entretien d’Etat par le système des intermittences
rente aux industriels)
DIMINUTION
le personnel de la conservation a connu une baisse de 17
%
STAGNATION
édition de livres et de disques
TENDANCE A LA
PRECARISATION l'évolution
n'échappe pas à la tendance dominante des autres
branches : la main-d'oeuvre stable recule et
l'intermittence tend à devenir la règle précisément dans
l'audiovisuel et le spectacle.
II°)Puis
la
suite s’organise autour de la succession ordonnée
ANALYSE ECONOMIQUE DES GRANDS SECTEURS DE LA VIE
CULTURELLE
A)
« l’economie des œuvres uniques »
DE CE QUI RESSORTIT, INDUISONS NOUS DE LA DIMENSION
SINGULIERE
AVEC LE CRITERE ABSOLU DU NON REPRODUCTIBLE CASSE TETE
SPECIFIQUE DE L’ÉCONOMIE DE L’ART,
MAIS CE CRITERE DOIT ETRE
RELATIVISE DANSLE SPECTACLE QUI EST SOUVENT
REPRODUCTIBLE EN SERIES MOYENNEMENT LONGUES.
3°) Le spectacle vivant*
(PRIMAT DE LA PRODUCTION ET/OU DE LA MEDIATION ?)
-le spectacle vivant, le marché de l'art, le patrimoine
et les industries culturelles.
*F. Benhamou, prend comme
argent comptant cet étonnant vocable de la novlang d'Etat
culturel en France.
Partant du constat que " la fréquentation de la plupart
des spectacles vivants
est plus élitiste encore que celle
d'autres institutions culturelles ", Françoise Benhamou
s'interroge sur l'offre et sur les politiques de
subvention des institutions. La grande fragilité
économique de ce secteur soumis à l'accroissement des
coûts " et à la quasi-absence de réserves de
productivité " conduit à un recours constant
-
à l'aide publique (État et collectivités locales)
-
ou au mécénat. La France privilégie la première,
les pays anglo-saxons le second.
Pourtant, l'équilibre financier, malgré cette
intervention massive et très inégalement répartie, fait
toujours défaut. Il en est ainsi parce que, selon le
modèle de Baumol et Bowen, deux économistes chargés
d'établir un diagnostic sur la situation des théâtres de
Broadway en 1965, seule une hausse des prix des billets
pourrait compenser la croissance permanente des coûts du
spectacle, au risque de réduire la demande... et les
recettes. Or, si des économies sont possibles, elles
restent insuffisantes et,
en France,
le théâtre vit essentiellement de subventions publiques.
80 % des budgets des cinq théâtres nationaux - Odéon,
Comédie française, Chaillot, La Colline, Théâtre
national de Strasbourg - proviennent de subventions de
l'État.
tout comme la musique, l'art lyrique
et chorégraphique. Le dilemme qualité/nombre de
spectateurs semble donc insoluble. En témoigne, aux yeux
de l'auteur, l'effet pervers du mécanisme de la
subvention qui, loin de faire baisser les prix du
spectacle, contribue au contraire à les augmenter et
ainsi exclure une stratégie de l'audience au profit
d'une stratégie de la qualité, nettement plus élitiste.
--------------------
4°) Le marché de l’art
Effectivement imbriqués : PRIMAT DU MARCHE SOUS RESERVE
DES MODES DE PRODUCTION ET DE LA FLUIDITE DU PATRIMOINE…
Mais en mettant ensemble les objets les plus polarisés
qui soient on semble
MARCHES DE L’ART ALIAS MARCHES FINANCIERS ? (jr sous
réserve d’avoir identifié la valeur esthétique durable)
Quant au marché de l'art,
il présente, de par son fonctionnement et l'importance
des mouvements spéculatifs dont il est l'objet, de
grandes analogies avec les marchés financiers Cf.
Raymonde Moulin, L'Artiste, l'institution et le
marché, Paris, Flammarion, 1992.
On est ainsi conduit à nouveau à s'interroger sur les
mécanismes qui concourent à
l'établissement de la valeur marchande de l'oeuvre
d'art, dans la mesure où "
- son prix, si elle a quelque valeur esthétique
reconnue, augmente au cours du temps.
-
La possibilité de la revendre lui confère, aux yeux de
l'économiste, le statut d'actif financier,
§
autorisant la comparaison entre le taux de rendement
des oeuvres et celui d'autres actifs ".
4° bis (J reault) NON TRAITE LA PRODUCTION VIVANTE SEMI
SERIELLE Création au sens strict – LIEN LOGIQUE
IMPORTANT AVEC LES INDUSTRIES DU PRODUIT REPRODUCTIBLE
EN L’OCCURRENCE
_ a)LA MODE
ESSENTIELLEMENT VESTIMENTAIRE…
Véritable NON
DIT DANS L’ANALYSE.
CF DEBRAY P HUGUES…
B ) LA CUISINE…. LE VIN LES ARTS DELA TABLE…
le patrimoine
«
Musées
Analysant d'autre part " la fièvre muséale "
des années 80, l'auteur met en lumière les
contradictions que soulève la gestion de plus en plus
commerciale des musées (recettes propres,
tarification, commercialisation de produits dérivés,
etc.).
Monuments historiques
Contradictions que l'on retrouve pour la gestion des
monuments historiques, preuve que " préoccupations
patrimoniales et préoccupations économiques ne font pas
toujours bon ménage " et, conclut avec raison
l'économiste Françoise Benhamou, " peut-être est-ce
heureux ".
Ignoré
par F Benhamou,
UN
PATRIMOINE NON INDIVIDUALISE NON DISCRET NON REDUCTIBLE
À LA LOGIQUE PRODUIT : MONUMENT..
LES VILLES et leurs quartiers LE BATI RURAL, TRADITIONNEL, LES PAYSAGES…..
--------------------------------------------------
B LES INDUSTRIES CULTURELLES LIVRES DISQUES CINEMA
Industries culturelles
En dernier lieu, sont abordées les industries
culturelles (livre, disque, cinéma). Cela fait à présent
soixante ans que ces dernières suscitent des analyses
aussi pertinentes que polémiques. L'investigation
systématique dont elles ont fait l'objet depuis et le
nombre impressionnant de publications qui leur est
consacré font qu'il s'agit d'un secteur désormais bien
connu dont l'importance économique, tant en termes
financiers qu'en termes d'emploi, n'échappe plus à
personne. On en trouvera dans ce livre une bonne
présentation synthétique, quoiqu'un peu rapide sur
l'essor du multimédia.
LES ŒUVRES REPRODUCTIBLES (à l’instar des produits
classiques du reste de l’économie) C’est là que sont
approchées les TECHNOLOGIES ET LA MONDIALISATION…
-Là aussi le rapport reproductibilité singularité
n’est pas si simple mais cela est dit.
-Insistance mise sur le poids des « majors »
organiquement inséparable de la sous-traitance de
l’innovation et du risque …
-Analyse de la vente au détail elle même en forte
concentration
-
Analyse de la mondialiation
BBB LA NON
INTEGRATION DE L’ECONOMIE DES MEDIA LAISSE L’ANALYSE DE
B EN L’AIR…
B)
COMME EN ENFER EST REPORTE A LA FIN L’ANALYSE DES
POLITIQUES CULTURELLES
OUTRE LES QUESTIONS CLASSIQUES ETAT /MECENAT,
PROTECTION/CONCURRENCE, LÀ SONT ABORDEES QUELQUES
QUESTIONS PLUS CIVILISATIONNELLES COMME CELLES DE
L’ASSECHEMENT DE LA CREATION DU SUPPOSE ECHEC DES
SUPPOSEES POLITIQUES DE DEMOCRATISATION
ETC…
Politiques culturelles.
C'est l'occasion d'une réflexion féconde sur leurs
fondements économiques et leur importance respective aux
États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, ainsi que
sur les philosophies qui les sous-tendent. Au total,
quelles que soient les critiques à l'encontre des
politiques publiques et des institutions culturelles -
rentes de situation et excès de protection,
bureaucratisation et dérive des budgets, inefficacité
redistributive, voire assèchement de la création, etc.
-, il n'en demeure pas moins selon l'auteur, qu'on ne
saurait s'entêter " à ne compter que les retombées
marchandes des investissements culturels ".
Autrement dit, il vaut mieux mesurer l'efficacité des
politiques publiques à l'aune de la qualité plutôt qu'à
celle de la fréquentation et de l'audimat.
Bel hommage de l'économie à la Culture, en vérité
!
LES ANGLES MORTS VOIRE LES DENEGATIONS de Françoise
BENHAMOU
Outre celles évoquées plus haut.
1°) ECONOMIE SOCIETES (Y C DEMOGRAPHIE)
CIVILISATIONS
LA QUESTION DE LA DEMANDE GLOBALE ET DE L’ORIGINE DE
L’OFFRE et de leurs RAPPORTS.
SEUILS DE POPULATION TOTALE MARCHE LANGUE
NATIONALES CIVILISATIONS CULTURES NATIONALES ET SOUS
CULTURES.
(même problème pousser la comparaison avec
l’alimentaire.
OFFRE MONDIALISEE ? AMERICANISEE ?
2°) LA QUESTION D’UNE CRISE ? CRISE GLOBALE DE
L’OFFRE DE LA DEMANDE DE LA CONSOMMATION CRISE DU
MONDE SURVIE DES NATIONS…
-TECHNOLOGIQUE
-
ECONOMIQUE
o
CIVILISATIONNELLE…
LA QUESTION DE L’HYPERBOURGEOISIE DE LA CLASSE
CUULTURELLEL DES OLIGARCHIES
o
EXEMPLE DE L’ART CONTEMPORAIN
DE LA DICHOTOMIE DANS LE SPECTACLE VIVANT
ENTREL’ART DE LA RUE DE MOINS EN MOINS ART DE PLUS EN
PLUS DIVERTISSEMENT ET ABANDONNE AU PEUPLE
Et THEATRE LEGITIME DES BARONS DU THEATRE ET DES
INSTITUTIONS DE L’ETAT CULTUREL.
3°) PLUS GENERALEMENT L’HISTOCIRICITE ;
L’EXCEPTIONNALITE DE LA CONJONCTURE… EN France ET DANS
LE MONDE
4°) LA GENERALITE INEGALE MAIS MOBILE DES
RESISTANCES CULTURELLES. Ce concept est strictement hors
champ de l'ouvrage qui montre ainsi son caractère
totalement intégré à l'Etat culturel avant d'être
"scientifique" …..
[I]
Cette partie constituait
la présentation
officielle du cours sur
les Livrets de
l’étudiant de l’UFR de
sociologie de
l’Université de Nantes
(2005-2008)
[2]
Fichier du 16 mai 2008
[3]On
reprend ici avec des
compléments et
commentaire le condensé
du cours donné dans le
livret de l’étudiant de
l'UFR de sociologie de
l'Université de Nantes.
[4]
Les 10 multinationales
« majors » des
industries culturelles
et multimédia. Texte
distribué.
[5]
(Ex Janvier 2007, Midem
baisse de
10 % de
l’industrie du disque,
-Mais
des 10 premiers
disques vendus sont en
France francophones),
mais
95 % des échanges
de musiques ou chant
passant par Internet se
fait hors rétribution
normale
[6]
Jacques Bertin,
journaliste culturel
d’investigation, le seul
ayant sans doute existé
et qui fut licencié de
l’hebdomadaire se disant
de gauche critique,
Politis, pour liberté de
parole
[7]
Ajouté depuis le texte
donné pour le livret de
l’étudiant.
[8]
On devra sur Nantes
et sa région distribuer
plusieurs articles de
presse dont deux
synthétiques de
l’Expansion sur les
leaders du busyness
culturel à Nantes
en 2003 et 2005.
S’il était besoin de
prouver que Nantes est
le principal principal
appendice de l’Etat
culturel national Lango-parisien,
ce choix exclusif de cet
hebdomadaire national,
relativement à aucune
autre ville, y
suffirait. Deux séances
de visionnage et
commentaires ont été
effectuées à partir de
l’émission de Télénantes
diffusée le 31 décembre
2005. « La culture à la
nantaise ». Enfin il est
recommandé de connaître
le chapitre V « Images
et cultures
nantaises »du livre
de Isabelle
GARAT, Patrick POTTIER,
Thierry GUINEBRETEAU,
Valérie JOUSSEAUME,
François MADORÉ. Nantes
de la belle endormie au
nouvel Eden de l’Ouest.
Economica-Anthropos2005
[9]
Un
vaste tableau panoptique
de l’articulation des
groupes financiers et
des unités des
industries culturelles
et médiatiques a été
distribué en cours.
[10]
G
o o g l e
http://www.enssib.fr/bbf/fiches_lecture/b971benhamou.html
extraite le 12 jan 2006
11:17:24 GMT.La
bibliothèque du
bibliothécaire Compte
rendu de monographies
Bulletin des
bibliothèques de France.
numéro 97-1
Paris : La Découverte,
1996. - 119 p. ; 19 cm.
- (Repères ; 192)isbn
2-7071-2549-0 49 F
résumé par
Jean-François Hersent
[11]
Cf. Olivier Donnat,
Les Français face à
la culture, Paris, La
Découverte,
1994.Curieusement, cet
ouvrage ne figure pas
dans l'abondante
bibliographie proposée
par l'auteur. On pourra
également se reporter à
Olivier Donnat et Denis
Cogneau,
Les Pratiques
culturelles des
Français. Évolution
1973-1989, Paris,
dep-mcc, La
Découverte/La
Documentation française,
1990.
[12]
Pierre Bourdieu et
Pierre Dardel,
L'Amour de l'Art,
Paris, Éd. de Minuit,
1969.
[13]
JR voir ci dessous le
colloque 2006
|














 Voeux
du LESTAMP pour
Voeux
du LESTAMP pour