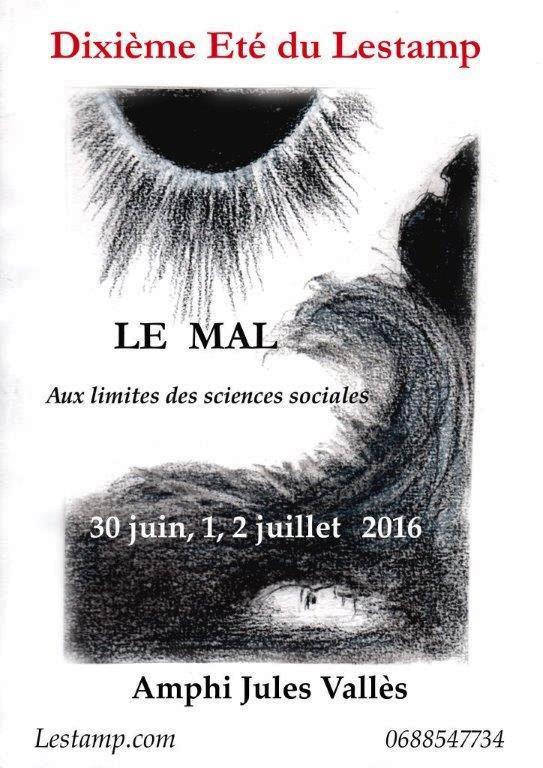Découvrez
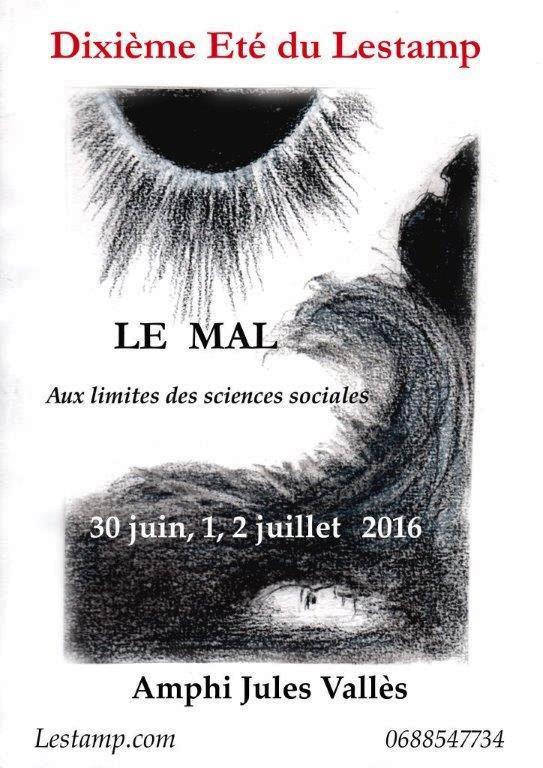
Pour
soumettre
un
projet
de com.:
joelle.deniot@wanadoo.fr
et
jacky.reault@wanadoo.fr
Entrée
libre
le youtube de
Jean Luc Giraud sur les dessins de Mireille Petit
Choubrac, l'artiste nazairienne ayant illustré le
livre de J A Deniot Edith Piaf La voix le geste l'icone
esquisse anthropologique Lelivredart 2012

Edith PIAF, la voix, le geste, l'icône.
de
ambrosiette
Esquisse anthropologique de Joëlle Deniot.
Livre préfacé par Jacky Réault, sociologue, illustré par
Mireille Petit-Choubrac, et publié aux éditions
Lelivredart. (automne 2012)
www.lestamp.com
Tissus traditionnels,
tissages anciens
Sont ici développés l’aspect tissu et
parole et rapport du tissu à la représentation, toujours
à partir de l’œuvre de Patrice Hugues et en appui
d’allusions faites en cours.

Tissu
préincaïque. Décor structural selon un jeu de diagonales
déterminant tous les rythmes du tissu ; Il comprend dans
tous ses chemins de motifs ;
le même motif hybride d’oiseau et de regard (cf polycope
papier prochainement distribué)
Approche de leur contenu cosmogonique et rituel
Avec l'exemple des premiers tissus
péruviens, énigme de l'oiseau et du regard, en se disant
il y a bien la forme d'un récit mythique (oeil et
oiseau étant des éléments que l'on retrouve dans bien
des cosmogonies de la création, de la représentation de
1'ancêtre, de dieu ... comme dans la mythologie antique
ou dans la mythologie égyptienne). Mais nous sommes tout
de même devant une forme-mythique en attente de contenu,
puisque le savoir ethnologique sur ces sociétés locales
et leur culte solaire, est finalement trop limité pour
pousser plus loin les hypothèses. La recherche de
contenu sera plus facile à développer sur trois autres
exemples suivants :
1° l'exemple du tissu chinois
2° l'exemple des broderies shoowas
3° l'exemple du tissu dogon
1. L'exemple
des tissus de l'ancienne
chine :
soieries de l'époque Han

Les soieries chinoises les plus
anciennes, qui nous soient parvenues, datent de l'epoque
des Han (206 avant J.C.) ; la chine pratiquant sûrement
le tissage de la soie déjà au II° millénaire, voire au
III° millénaire, avant notre ère.
Le motif du dragon
est un
des plus répandus sur les tissus de cette époque. On le
retrouve dans le tissage commun et dans le tissu de luxe
; il est un des plus anciens aussi.
Bien sûr, dans le rapport entre le mythe et le tissage
... il est évident que 1'anciennete des mythes plonge
infiniment plus loin dans la nuit des temps que le passe
des
tissus.
Le tissu enregistre, inscrit les signes parlants d'une
tradition orale de la transmission des mythes d'une
ethnie. II fait entrer le mythe en correspondance avec
plusieurs types de signes graphiques, abstraits ou plus
figuratifs. Le tissage est une transcription de la
tradition orale
immémoriale.
Le dragon
: cet
animal est le résultat d'une hybridation symbolique, il
est figure hybride dans la mesure ou il renvoie :
- à un animal évoquant, peut-être, de façon lointaine,
les anciens monstres disparus.
- mais également a 1'union sexuelle du laboureur et de
la tisserande (mythe stellaire de l'opposition et du
mariage des 2 divinités : le Bouvier et la Tisserande.
Le Bouvier, principe masculin et la Tisserande,
principe féminin. Ce couple correspond d'ailleurs au
couple de la vie rurale réelle.
Le dragon
est
figure d'hybridation, de confluence, d'union sexuelle,
d'union exogame. Il est symbole populaire, né des danses
collectives, comme la plupart des figures emblématiques
tissées, aussi bien que calligraphiées, de l'ancienne
chine. A l'origine, c'est ici le geste danse qui se
ritualise dans le tissu, qui se concrétise dans
l'espace-temps, dans l'objet-tissu. Le tissu concrétise
et la danse - nous avons dit qu'il était rythme - et
l'emblème qui entoure le mythe.
Nous débouchons alors sur la relation Rite/Mythe/Danse.
La danse est également une structure de répétition qui
va permettre de dire, redire le mythe, de le convoquer a
réactualisation. Le tissu inscrit spatialement sa propre
structure répétitive (nous avons vu que le tissu est,
par trait structurel, la répétition illimitée). Le
rythme du tissu confirme la ritualisation de la danse.
II confirme la ritualisation du mythe, en incarnant de
manière plus stable, plus aisément transportable, les
figures emblématiques.
Exister aux yeux de tous dans une actualisation
persistante.
A la différence du chant et de la danse qui sont
symbolisations instantanées, toujours réitérables, mais
fugaces, le tissu capture l'emblème, ici, le dragon...
et il redit le mythe stellaire du laboureur et de la
tisserande, il dit 1'union sexuelle de l'un et de
l'autre, il dit la ritualisation dansée du mythe et il
donne son incarnation a l'animal fabuleux.
II faut
insister sur cette fonction imaginaire du tissu primitif
qui consiste à
donner
une existence "objectivée" aux créations fabuleuses,
légendaires.
La légende qui, auparavant, n'était que voix...
autrement dit souffle éphémère dans le vent, va
désormais s'inscrire dans un objet que l'on peut
diffuser, transporter, échanger.
2.
L'exemple des broderies Shoowas
On passe en Afrique (broderies Shoowas -
royaume de Kuba : centre de l'actuel Zaïre, ces tissus
sont beaucoup plus récents : XVIII0, début
XIX0. II s'agit d'ethnies pratiquant
l’agriculture en bordure de foret équatoriale dans des
circonstances de paix, d'isolement relatif qui ont
favorise une relative promotion des femmes tandis
qu'elles, diminuaient le rôle des guerriers, sinon des
chasseurs. Dans la plupart des tribus, les femmes
pratiquent la broderie, avec des résultats
spectaculaires, des velours brodés. Ce sont
les hommes qui tissent et les femmes qui
brodent. La colonisation a fait disparaître ces
pratiques, restent les collections.
Curieusement ces broderies nous disent autre chose de la
relation au mythe. On a parlé du rapport du mythe à la
danse rituelle ; les mythes vont aussi s'inscrire avant
le tissu, sur la peau, cette première toile à imprimer.
En fait, la première stabilisation des figures ayant
relation avec les scènes mythiques vont se tatouer, se
dessiner en autant de tatouages sacrificiels... Avant la
ritualisation fixée entre fils de chaîne et de trame, il
y a l'entaille et la cicatrice, pour dire 1'initiation a
la connaissance mythique. Les tissus qui ont rapport
avec les traditions orales, avec la danse, ont aussi
rapport avec ces premiers marquages du corps, ces
dessins sur peau humaine, ces traces initiatiques. Nous
disions le tissu a constitue 1'un des premiers schèmes
spatio-temporels fixes du mythe... la peau l'a précédé
(mais ce n'est pas un objet transportable).
Les broderies shoowas reprennent les premières
inscriptions rituelles sur la peau. El les sont
directement passées du tatouage à la broderie Ce qui
signifie que les femmes d'ordinaire non initiées,
eurent, par la broderie, accès au langage initiatique.
Car ces tatouages cicatriciels pratiques rituellement
sur le corps étaient les signes- témoins de 1'acte
d'inceste commis, selon le mythe, par le démiurge Woot
avec sa soeur.
II s'agit
d'évocations partielles par signes graphiques,
géométriques de la
cicatrice -témoin de l'inceste et non
de la figuration d'un tel mythe incestueux. Les
traces de l'évocation mythique vont être repris dans
le motif brode, mais complexifie par référence
aux anciens tressages et entrelacs des vanneries et
surtout par référence aux nattages représentant
les parois des cases.
Grâce a la broderie exclusivement réservée aux mains des
femmes, de générations en générations, il y a :
- Initiation au mythe, a la cosmogonie, en signes et
connaissances partiels.
- Récupération d'écriture cicatricielle dont elles n'ont
pas la maîtrise.
- Symbolisation de 1'activite de vannerie et de nattage,
maîtrise des décors du foyer.
- Maîtrise de marquage des parois, de la peau de
l'habitacle, sinon maîtrise de marquage de la surface
des corps.
Le tissu brodé dit le statut des femmes shoovas
dans l'initiation cosmogonique et dans la
division hiérarchisée des taches. Maîtrise veut
dire droit sans partage. Les femmes ont le droit
exclusif d'interpréter les motifs brodes, de les nommer,
de les changer... même s'ils apparaissent, sur bois,
sous la main des hommes. De plus, ces femmes, seules
lectrices de leurs broderies, ne sont pas seulement
consommatrices du mythe ; dans ce mariage entre tatouage
et arts du nattage s'inscrit une dynamique de création
et d'invention spécifiquement textiles, susceptibles de
modifier certains éléments de
la mythologie. En décidant d'accentuer, de varier les
fils, les couleurs, les points, elles créent d'autres
voies d'accès au mythe, constituent d'autres rapports
entre les éléments. Elles gravent autrement leur place
dans l'initiation mythique dont elles sont partiellement
exclues.
II y a division sexuelle des supports de l'expression
esthétique et division sexuelle des formes esthétiques.
Bois, gravures, sculptures sont réservés aux hommes.
Mais le privilège féminin de la lecture des signes
cosmogoniques ritualises dans le tissage, n'implique pas
la simple possession d'un langage traditionnel,
puisqu'il y a intervention possible sur le récit, la
configuration mythique par la pratique et la mémoire
gestuelle des fils brodés.
Notons que dans ces tissus, le mythe ne se trouve ni
raconte, ni figure ; il s'agit ni d'une image, ni d'un
récit linéaire. Le mythe, résultat d'une pratique
collective, n'est pas la représente, mais rendu réel,
présent par ces signes partiels formant un ensemble
répété, continu, unifié. Les signes sont lus, décryptés,
comme un code par ceux qui en ont la connaissance et le
pouvoir. Les tissus rituels sacres permettent, non pas
la représentation mais la concrétisation du mythe. On
peut dire que la danse, le théâtre ancien, sont
représentation -apparition du mythe. On va dire que le
tissu rituel sacre est incarnation partielle, fétiche
substitutif fabrique, possède, capte des origines
perdues, des grandes légendes inaccessibles.
Il s'agit de différents niveaux de symbolisation, de
mode d'évocation du sacre, de restitution de l'origine
absente qu'une image, un récit ne rendraient
certainement pas avec autant de force. Le signe partiel
capte dans le tissu est sans doute une de ses
symbolisations les plus impressionnantes et les plus
expressives.
3. L'exemple des tissus Dogon

L'exemple des Dogon - ethnie du Mali - a
été rendu célèbre par les études de Marcel Griaule (Dieu
d'eau) et Geneviève Calame-Griaule (La Parole
chez les Dogon). Là nous trouvons une très belle
analyse de la voix comme élément de la cosmologie et de
la cosmogonie : la voix qui, comme le tissu, est cet
élément le plus matériel, de la parole.
II y a là un exemple remarquable de rapport entre tissu
et parole dans le cadre d'une civilisation, purement
orale, exempte de tout enregistrement de son histoire
par l'écriture. Or le mot tissu en Dogon - soih -
veut dire "c'est la parole". Le tisserand - sointi
-est celui qui fait la parole. En croisant fils de
chaîne et fils de trame, l'homme est vêtu de sa propre
parole.
Dans la mythologie Dogon, le Nomo communiqua aux
hommes la parole par le tissage. Comme l'araignée
produit ses fils ... l'ancetre mythique crache 7, 8 fils
de coton qu'il sépare en deux parties égales entre ses
dents - dents supérieures - fils pairs - dents
inférieures - fils impairs - évoquant le peigne du
tisserand. En ouvrant et fermant la mâchoire, le génie
reproduit le mouvement vertical des lisses permettant le
passage des fils de trame. La pointe de la langue du
génie assure les fils de chaîne et la bande de tissu se
forme hors de sa bouche "dans le souffle de la parole
révélée".
Le Tissu est alors parole au sens le plus littéral.
Le bruit de la poulie lançant la navette signifie
"murmure de la parole".
Tisser, c'est parler.
Parler, c'est tisser.
Le tisserand dogon chante en lançant sa navette et sa
voix entre dans le fil de la voix des ancêtres.
Tisser, c'est parler comme l'ancêtre, le
tissage est parole immémoriale, hors du
temps.
Parler, c'est tisser... c'est se retrouver assimile à
toutes les autres activités créatrices de l'homme, c'est
engendrer le monde de la culture.
Le va et vient du paysan est comme celui de la navette,
dans son champ forme de parcelles en damiers, analogues
aux carreaux tisses de la couverture des morts.
La symbolique du tissu est ici originelle, elle permet
d'établir une correspondance rituelle absolue entre
toutes les activités humaines, recréant toujours la voix
et le geste de l'ancêtre qui donna naissance au groupe.
On ne peut pas trouver d'exemple ou le tissage soit a ce
point parole ... puisque sa métaphore englobe toutes les
activités de production et de culture. Toute la société
dogon se nourrit et se lit a travers cette cosmogonie de
la parole tisserande de l'ancetre fondateur ... que l'on
ne peut que reproduire. Ce qui implique bien sur, malgré
les variabilités du chant du tisserand, des paroles
ritualisées, une forte codification des énoncés.
Parallèlement on constate chez les Dogon une grande
codification des rituels de salutations, une grande
codification des tessitures de la voix, une grande
qualité d'écoute et de réception de la voix émise. Les
civilisations de l'oralité ont développe des finesses de
la réception auditive, des sensorialités vocales qui
nous sont difficilement perceptibles, presque
inaccessibles. On peut constater un parallèle suggestif
entre cultures du doigte (le tissage, le tissu) et
cultures de la communication verbale (toucher de l'autre
par les mots).
Du tissu à la représentation
Les tissus traditionnels, primitifs des
civilisations orales étaient médiateurs d'accès, au
grand mythe fondateur. Ils étaient pareils à des
séquences incantatoires du sacré, mais plus stables,
plus objectivées que la parole, le chant ou la danse.
Ils étaient symboles sacrés incarnant, réifiant l'absent
... sans le figurer. Ces tissus "parlants" sont a
l'opposé de la représentation imagée, comme le sera
l'icône de la chrétienté.
Il y a un rapport spécifique a l'image dans la religion
catholique et romaine qui reconnaissant l'incarnation,
va admettre la figuration divine. Toutefois, cette
politique de l’ image religieuse restera très contrôlée.
On a la ni la "décontraction" grecque par rapport
au
simulacre, ni l'ascèse iconique de l'ancien
testament, que suivront les églises Orthodoxe, Juive et
Byzantine.
La
civilisation occidentale sous la double impulsion :
- d'un clergé instaurant l'image comme support de la
foi,
- d'une noblesse, en ses fastes de cour, valorisant la
compétition des regards, autrement dit, le contrôle des
comportements, va choisir l'esthétique de la
représentation : le miroir et le tableau.
Clergé et
noblesse, a partir de la Renaissance, deviennent les
grands commanditaires des oeuvres. Une représentation
figurative en perspective, figurant les personnages qui
entourent la vie et la mort du Christ, et devenant de
plus en plus humains. C'est la grande période de l’Art
de la Renaissance (Michel-Ange, Lippi, Pontormo,
Masachio etc...) L'objet d'Art s'autonomisant du sacre
est ne ... et ce, sur la scène de l'image, dans l'espace
pictural.
La Société vénitienne cultive mascarades, et jeux
d'apparences.
Venise au XVième siècle crée le miroir,
crée le reflet, le double sépare de soi, la distance
inquiète à soi : silhouette, corps objective en sa
morphologie, son visage. Dans le miroir, le sujet
devient objet, visage immobilise, corps immobilise ; la
mort y saisit le vif.
Les maîtres italiens de la Renaissance créent la
perspective, la vision du miroir met an centre la
perception de l’oeil, l'illusion de la profondeur
recréant le regard naturel, mais s'opposant a la vision
plus intérieure, d'une autre nature que ces jeux
d'optique.
Cette
image narrative est bien différente des
signes
abstraits du mythe parcourant
les
tissus.
Dans cette logique miroir -tableau, on va
intégrer le tissu et ses valeurs d'amplification lyrique
(expression baroque du tragique). La religion
catholique, par le tissu voile le corps du sexe, du
péché. La représentation picturale prend a son compte
cette logique de la spiritualisation du corps par
l'étoffe. Mais il n'est plus que du tissu représente. Et
chose paradoxale, la tapisserie, art vénitien et
hollandais, va se mettre à imiter .la représentation
picturale.
II y a perte de la spécificité de
l'expression textile ou l'oralité, la mémoire des
gestes, la proximité du toucher des choses, des symboles
fabuleux sont au centre d'une civilisation développant
les sensibilités mentales et relationnelles du tactile.
Dans la suite de ce cours, mais sur un plan différent
deux textes brefs de Patrice Hugues, dans la lignée de
sa réflexion si tissu biologique et tissu, né du
tissage.
Autour de
l’unique question qui se pose
L'avantage qu'il y a à suivre l'évolution
des civilisations d'après le trajet d'un simple objet
comme le tissu, est que cela simplifie la lecture de ce
mouvement qui peut dons être mieux saisi d'ensemble. Et
les sauts- confrontations entre les différents temps,
les différentes époques peuvent ainsi mieux garder leur
caractère d'ensemble précisément qui permet seul d'oser
des conclusions ou propositions procédant d'une vision
réellement synthétique et transhistorique. Jusqu'aux
incidences les plus renversantes qui doivent absolument
être reconnues, pour qu'il y ait les changements de
point de vue radicaux nécessaires.
Alors que les niveaux de lecture savants et bien au
dessus du trajet d'un simple objet comme le tissu
doivent traîner tout un charroi plus large que la route,
beaucoup trop lent pour le temps qui s'ouvre et qui
passe déjà au suivant. Ne pas s'encombrer des
préventions à rester au niveau élevé des "essentiels
reconnus" qui constituent le discours habituel des
historiens, des sociologies ou même bien souvent celui
des philosophes ... Trop retardés, incapables d'avancer
assez vite ni assez complètement pour que les
changements de signes et de sens dans le mouvement
puissent être aperçus et saisis, ils ne délivrent aucune
vision "renversante", seulement des classements et des
reclassements et des enchaînements en général bien trop
courts.
L'unique question qui se pose,
le
problème le plus important à résoudre c'est : comment -
au delà de
la vie qui s'éprouve surtout
dans les étroites limites et proportions de nos vies
individuelles -s'accomoder de l'insertion de l'homme
dans l'évolution des espèces, comme être vivant survenu
tel à partir de la
succession de nombreuses espèces animales, et attenant
donc à l'animalité, d'une part,
sans qu'il y ait, d'autre
part, un auteur- créateur, infiniment plus vaste que
soi, qui ait pensé et pense
le monde; sans
qu'il y ait non plus un devenir "plus humain" d'assuré ?
Savoir que tous les édifices et "progrès"
de la civilisation ne sont et ne peuvent être que des
prolongements à partir de là.
Ce qui
n'est pas si mal.
Sans trop craindre que la poursuite de ces prolongements
"humains" s'arrête bientôt et qu'ils n'aient
pas devant eux un avenir
infini. Tous ces
"prolongements" ne peuvent se former qu'à partir de la
vie, des vies humaines qui se
succèdent: c'est l'unique zone
de régulation, de mise en oeuvre, de production du
nouveau dans
l'évolution de l'avenir, dans l'evolution des espèces.
C'est, je pense, dans ce sas-là, le sas de la vie,
que tout doit être étudiée
maintenant.
II faut donc s'acharner a bien
reconnaître ce qui dans les moeurs, la pensée, le
sentiment, l'action est vie véritable et agent positif
dans le sens de cette vie créatrice de prolongements
"humains". (Exemples dans
l'évolution des moeurs : est-ce que les manipulations
génétiques abusives, les clonages, la procréation
assistée poussée à ses extrêmes (avec donneur inconnu,
mère porteuse...) aident à coup sûr dans ce sens ? Et le
développement de l'homosexualité (HH et FF)? Est-ce que
la parité HF et l’amour d'enfant dans le couple ne vont
pas bien davantage dans ce sens ? Oui ou non? Dans le
sens d'une mixité forte ?).
A cet effort de reconnaissance
sagace, le tissu peut aider comme un indice de tous les
instants sur le trajet qu'il accomplit avec nous. Tant
de choses ont été ressenties, notées et communément
vécues dans l'usage, le porter, les présences du tissu
de nos vêtements, les linges, les tentures, les
rideaux, que c'est la un gisement aux ressources
d'expression inépuisables, en emploi direct tel quel ou
en emploi inhabituel (1). Ces ressources d'expression
sont bien plus sensibles a chacun, bien plus connues de
tous, bien plus largement pratiquées, bien plus
intimement ressenties que les mots, bien plus vitales et
vivables et vécues que les images même ; aucune
ressource qui soit aussi familière et qui soit aussi
naturellement appropriée a chacun de nos gestes. C'est à
peu près comme entrer et sortir.
Ce qui est a portée de nos perceptions immédiates peut
être retenu comme ayant le plus souvent valeur d'objet,
comme ayant corps et forme;- en somme tout ce qui peut
être saisi au moins par la vue et le toucher (plus les
trois autres sens en bien des cas).
Le Tissu
-objet, l'objet- tissu
mérite le plus grand intérêt, ou au moins un plus grand
intérêt, maintenant. Parce qu'il est bien l'élément de
continuité qui est le mieux en correspondance avec tout
ce a quoi la biologie nous a introduit depuis 70 à 100
ans et surtout dans les 20 dernières années - y compris
bien sur la biologie moléculaire. Tissu et tissus
biologiques ?
Différence radicale avec le temps antérieur ou la
matière physique et la chimie des éléments retenaient
principalement l'intérêt sans une pareille concurrence
du cote du vivant. Opérant bien plus par des mesures
dans l'espèce et le temps, de rayonnements, d'énergie,
instrumentant l'optique, donc allant avec lentilles et
miroirs jusqu'aux particules, mais, sur cette voie,
ignorant le vivant et aussi bien le tissu.
Cependant le tissu n'est jamais qu'une mince couche de
fils en grand nombre, qui s'entrecroisent en comptes
très précis selon une structure rigoureusement ordonnée
et régulière a rythmes répétitifs (éventuellement en
plusieurs nappes : en double ou triple étoffe), ou des
plis imprévisibles et mouvants peuvent se former sans
cesse dans l'instant de nos gestes et de notre
respiration. Retenir avec le plus grand intérêt le
tissu, qui n'est qu'un objet, cela veut dire
implicitement mettre en avant la nécessité d'un nouveau
rapport entre l’être et I'objet. En tenant bien entendu
compte du rôle tout à fait spécifique du tissu qui
s'établit toujours au passage, a la limite de notre
corps, pour servir de "passeur" à l'être.
"Réification" des idées, avec ces histoires de Tissu ? -
Non pas.
Mais inversion nécessaire, avec les temps nouveaux, de
certains signes de base :
- non plus laisser de cote la matérialité des objets
humains : condition première depuis si longtemps d'accès
a la transcendance ;
- au contraire, pour une part, revenir a la réalité
concrète des choses, des objets, comme parties prenantes
de "l'etat du monde" (Wittgenstein), pour retrouver les
voies de l'immanence, aussi. (Sans renier pour autant
les voies de la raison et de l'abstraction).
Dans tout cela, il ne s'agit jamais que de la question
du changement de sens des signes dans certains de nos
fonctionnements de base : + devient - et - devient + :
Dans
un rapport radicalement
nouveau entre sujet et objet comme entre objet et
pensée, selon un nouvel équilibre.
Et ceci d'autant plus justifie que le
"virtuel" et les avantages de la numérisation, avec
lesquels nous sommes désormais engages, impliquent, en
contrepartie pour garder tout leur attrait, que nous
saisissions les réalités les plus immédiatement
concrètes les plus fortes, telle celle du tissu, qui
s'offre au plus près de nous constamment. De fait, en
raison de sa structure, la structure tissée, qui est
elle-même une structure entièrement numérisée, le tissu
permet un rapport concret- abstrait, assez rare, avec ce
monde de la numérisation et du virtuel.
(I)- Le tissu peut prendre effet comme si
c'était encore I'emploi usuel, même si on est dans une
association qui n'a jamais etc d'un emploi courant, qui
n'a jamais en cours dans nos habitudes.
Le tissu entre le sens commun et le "vécu moyen"

Tout près du "vécu moyen ", le tissu relève cependant
d'un véritable sens commun. Aujourd'hui le sens commun a
peu de place en comparaison du "vécu moyen" d'un "peuple
moyen"; c'est bien devenu "la chose du monde la mieux
partagée", ce "vécu conforme ou de substitution" par
imposition des medias (1). Tandis que les religions et
les idéologies dérivent et qu'autre chose se passe,
l'informatique et Internet perturbent et modifient
radicalement les fonctionnements mentaux et
intellectuels dont nous avons une si grande habitude.
Bien plus qu'ils ne modifient ceux du sexe. Dans
l'incertitude qui en résulte à bien des niveaux de
1'activite intellectuelle et psychique, la "certitude du
sexe" prend la valeur refuge et super- attractive du "hinc
et nunc", ici et maintenant. Doublant ce sens commun
défaillant, le sexe, qui est bien ce qu'il y a de plus
semblable de l'un a l'autre et de l'une à l'autre, est
le seul "vécu moyen individuel" possible, il se presse
de combler le vide . Même assujetti aux medias lui
aussi, il les déborde en partie (même si un "vécu sexuel
de substitution" est lui aussi plus que jamais possible,
justement par les medias). Plus concret et bien plus
physique que le sens commun, le sexe est et reste par sa
nature, comme le patrimoine génétique de chacun, acte de
soi et d'une pratique rigoureusement individuelle (même
pour les échangistes) (2).
Or Le tissu est "dans" le sens commun, comme le langage,
tellement il est a tout le monde. Tantôt sublime,
tantôt méprisé, il intervient toujours dans l'entre-deux
silencieux de nos vies et sert bien des régulations
vitales pour chaque être. II est d'un emploi certes
d'abord individuel; comme tel, il sert aussi bien le
sexe, le secret ou l'expression de soi. II peut aussi
bien servir l'esprit, le spirituel. II intervient en
même temps entre nous, dans le milieu, dans le commun.
II joue son jeu très proche du "vécu moyen" mais quand
même il est inaliénablement personnel, toujours pour une
grande part implicite et silencieux. Dans une position
imprenable, tellement il est au passage "d'un sens
commun", au niveau de l'implicite. C'est ce qui lui
permet de garder intacts et opérants tous ses
pouvoirs."Hic et nunc".
En complément
1) - Le bon sens et le sens commun ?
S'agissait- il pour Descartes d'une seule et même
capacité humaine: usage spontané d'une forme immédiate,
naturelle, de la raison, "la chose du monde la mieux
partagée " d'un côté, de l'autre intuition naturelle
commune a tous de toute une série de "vérités"
premières? Les deux sont à peu de chose près
superposables. Qu'advient-il quand on en arrive "au
peuple moyen" d'aujourd'hui? II n'est plus possible de
dire que le sens commun est demeuré intact, qu'il
fonctionne toujours aussi sûrement : à la place s'est
logé "le vécu moyen", plus le sexe . Le sens commun de
Descartes laisse place aux dérèglements de l'imaginaire
dès lors que le sexe remplace Dieu. Descartes aurait
aujourd'hui à revoir la distance entre sens commun et
raison : duo à remplacer complètement à moins qu'une
admirable régulation ne survienne justement a l'heure
présente, introduisant de nouveaux équilibres. Une
nouvelle cité, ni celle de Dieu, ni celle du sexe. Et
d'abord celle de l'égalité dans la différence HF, celle
de la vie, celle de I'enfant. Mais cela supposerait que
le triangle oedipien se manifeste"dans la cité" sous une
forme qui ne serait plus la tragédie, plutôt respect et
amour mutuels : soit Jésus-Christ plus son épouse et ses
enfants, nullement immortels, bien sur terre et aimant
beaucoup de monde.
2) -Le goût de I 'argent est de la même veine que le
sexe : le pouvoir et I 'attrait de l'argent sont proches
parents de ceux du sexe et vont suivant le même courant.
Le rapport de l'argent et du tissu mériterait pour
lui-même une étude. Ou 'est-ce qu'elle ferait apparaître
entre outre ? Si le tissu est nomade et mobilier, I
'argent est bien plus mobilier encore, et maintenant
plus que jamais avec la téléfinance. La structure tissée
du tissu est la première structure numérisée apparue
dans la civilisation, le fonctionnement de l'argent a
toujours été lui aussi numérique, mais à l'heure de la
numérisation généralisée, le fonctionnement de l'argent
devient l'extrême de l'instabilité, tandis que la
structure pérenne du tissu représente une stabilité. Et
l'argent, s'il est affaire de compte comme le tissu, se
pratique bien plus loin du corps. II ne peut servir des
régulations aussi vitales que le tissu. Au contraire,
comme le sexe, il est susceptible d'engendrer des
dérèglements redoutables.
Le
tissus du monde ... pour un paradigme de
l'anthropologie
(1)


Ce cours est
réalisé
par Joëlle DENIOT
Professeur de Sociologie, Responsable
du Master Culture - Université de Nantes
_________________________________
Evènement
Table
ronde du 7 septembre 2012 à la Galerie Delta à Paris autour du livre de Joëlle Deniot,
Edith Piaf, la voix le geste l'icone
Esquisse anthropologique et du vernissage de l'exposition de
l'artiste nazairienne Mireille Petit-Choubrac illustratrice du
livre.- Création sur Youtube de Jean-Luc
Giraud, sur les prises de vue de Léonard Delmaire
Cliquez
sur l'image pour accéder au
Youtube de 26 minutes.
©
Joëlle Deniot, Professeur
de Sociologie à l’Université de Nantes
 |
Sciences sociales
Transmission et humanités Quel déni ? Quelles dettes ?
Anthropologie
Histoire
Philosophie
Sociologie
Etudes
grecques,
latines Langues
civilisations
L'urgence de
s'interroger sur
les
transmissions
effectives dans
une société qui
se définit dans
la l'immanence
d'un présent et
la fuite
illusoire dans
le
projet
La sixième
édition de
L'Eté du
Lestamp (quatrième
du Lestamp-Habiter-Pips)
se déroulera à
Nantes
les 27, 28, 29
juin 2011 à la
Médiathèque de
la Fosse à
Nantes
Soumettre les
propositions à
joelle.deniot@wanadoo.fr
ou
jacky.reault@wanadoo.fr
- ou 06 88 54 77
34
|