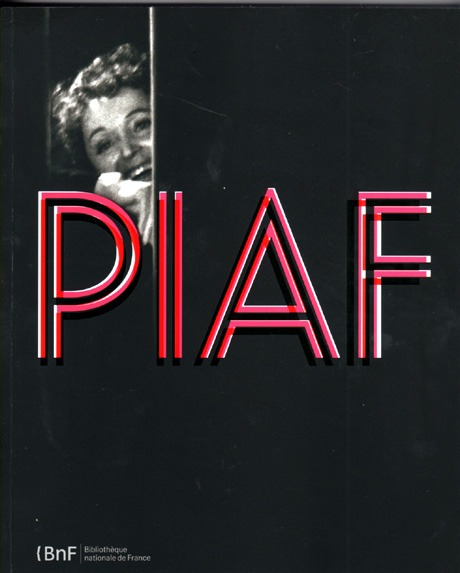|
Ce cours « Le ministère de la
Culture, d'André Malraux à nos jours, Une exception
française ? » sera construit chronologiquement, pour
mettre en valeur les évolutions du ministère sur un
demi-siècle et les changements tant de la politique
culturelle que de sa réception par les différents
acteurs et les types de public.
Le fil
conducteur de la réflexion sera principalement la
philosophie et les ambitions de cette politique
culturelle publique ; parallèlement, une attention
particulière sera portée aux structures administratives,
mais aussi aux personnalités marquantes (ministres,
membres des cabinets, directeurs de grands
établissements), ainsi qu'aux grandes réalisations à
Paris et en régions depuis cinquante ans.
Bibliographie de base
Dardy-CRETON M.,
Histoire administrative du ministère de la Culture,
1959-2012, Paris, la documentation française, 2012.
FumarolI M.,
L'Etat culturel. Essai sur une religion moderne,
Paris, De Fallois,1991.
POIRIER Philippe,
Les politiques culturelles en France, Paris,
Documentation française, 2009
Saint-Pulgent M. de,
Le gouvernement de la Culture, Paris, Gallimard,
1999.
Waresquiel E. de,
(dir.), Dictionnaire des
politiques culturelles de la France depuis 1959,
Paris, Larousse/CNRS, 2001.
Saint-Pulgent M. de,
Culture et communication. Les missions d'un grand
ministère, Paris, Gallimard, coll. découverte n°
539, 2009.
________________________________________
UE 91 Sémiologies et sciences sociales
Mme
Joëlle Deniot
Après
avoir souligné la centralité de la question du langage
dans l’approche des faits sociaux et la centralité des
marqueurs linguistiques dans la pratique des métiers de
la culture, le cours s’orientera sur des questions
globales de sémiologie où il sera question et de langue
(système audio-phonatoire) au sens strict et d’autres
registres du signe, l’image en particulier, dont toutes
les structures de médiations culturelles sont fortement
consommatrices et productrices.
Le débat concernant le rapport entre langue, pensée et
réalité, posé par les fondateurs de la philosophie
occidentale, pour aussi ancien qu’il soit, mérite d’être
repris pour bien saisir les enjeux de cette
catégorisation du réel opérée par la langue. C’est tout
le processus socialisé de symbolisation du rapport des
hommes entre eux qui passe par le langage. Nous
examinerons comment des pentes d’anomie sociale, des
pentes de vacance institutionnelle s’accompagnent de
notables désinvestissement langagiers : perte du récit,
érosion des mythologies, déclin des valeurs
d’intellectualité dans l’institution scolaire elle-même,
effacement du littéraire, comme univers mental et
imaginaire d’un idéal du moi. Parallèlement à cet
appauvrissement, « fleurissent » des novlangues dont le
lexique envahit notamment le marketing communicationnel
des politiques culturelles actuelles. Face à ces
novlangues qui sont aussi celles des experts, que
deviennent les notions de langue commune, de parlers
populaires, dans un contexte où l’on note pourtant le
revival des langues régionales Sociolinguistiques du
signe, anthropologie du symbole, problématiques de
l’image et problématiques de l’argumentation constituent
les quatre axes fondamentaux de ce cours
Bibliographie
AMOSSY RUTH,
L’argumentation dans le discours, Armand Colin,
2006
BARTHES ROLAND,
La chambre claire, Gallimard, Seuil, 1980
DENIOT Joëlle-Andrée,
Edith Piaf, la voix, le geste, l’icône, esquisse
anthropologique, LELIVREDART, Paris, 2012
GOFFMAN ERVING,
Les rites d’interaction, Minuit, 1974
ORWELL GEORGE,
1984, Gallimard 1950, Folio 2002
SALMON CHRISTIAN,
Verbicide, Climats, 2005
SAPIR EDWARD,
Le langage, introduction à l’étude de la parole,
Petite Bibliothèque
SECA JEAN-MARIE,
Les représentations sociales, Armand Colin, 2005
________________________
UE 91 Cultures, langages et identités
M. Hervé Quintin
La
déclinaison de ces trois concepts majeurs fait d’emblée
apparaître à la fois leur très forte imbrication et une
configuration particulière de l’ensemble ainsi
constitué. Si la notion de Culture s’affirme bien en
tant qu’entrée, la question de l’identité étant posée
comme visée, les langages, au premier rang desquels les
langues, figurent au centre de cette constellation.
Cette position en charnière peut s’interpréter de
multiples façons : langues/langages comme expression
mais aussi fondement de la culture, langues et langages
comme facteur et vecteur d’identité, ou encore comme
trait d’union, point de passage entre cultures et
identités.
Le cours partira de ces réflexions générales pour
explorer les relations qui s’établissent entre ces
différents champs, en prenant appui sur un certain
nombre de questionnements relevant de la linguistique,
de l’anthropologie culturelle, de l’histoire culturelle
– depuis les premières réflexions engagées à la fin du
18ème siécle dans divers pays d’Europe sur le lien entre
langue et culture jusqu’aux interrogations plus
récentes, voire contemporaines développées dans divers
contextes de redéfinition des identités, en Europe et
au-delà, sur des bases historiques et sociologiques.
Parmi d’autres sujets, seront plus particulièrement
examinées les questions suivantes :- Quelle place
assigner aux langues et autres langages dans la
définition et la perception de la culture.des cultures.
Y-a-t-il une spécificité des langues naturelles en tant
que fait culturel ?
- Quel est l’impact du fait linguistique sur le
développement culturel, quelles en sont ses limites :
diversité linguistique, diversité culturelle ;
- Langues, langages et production culturelle – peut-on
penser la culture sans la langue ?
- Identité linguistique, identité culturelle : langages
et identités sociales ; - La perception de l’étrangeté :
identification et différenciation : identités entre
réalités et représentations ;
- Identité, culture et mémoire : discours et mémoire ;
- Mutations culturelles et recompositions identitaires –
la culture comme « langage » de l’identité ?
Dans ce travail d’investigation, il sera fait appel à
des matériaux, exemples et documents relevant de
différentes aires culturelles et différentes époques
historiques.
Bibliographie
ABOU, S.
(1981) : L’identité culturelle. Anthropos, Paris.
BOURDIEU, P.
(1982) : Ce que parler veut dire. Fayard. Paris.
GREIMAS, A.J.
(1976) : Sémiologie et Sciences sociales. Seuil.
Paris
HUMBOLDT, W. v.
(2000) : Sur le caractère national des langues et
autres écrits sur la
langage,
ed. D. Thouard. Point/essais 425, Seuil. Paris
KRISTEVA, J.
(1988) : Etrangers à nous-mêmes. Fayard. Paris
LADMIRAL J.R. & LIPIANSKI E.M
(1989) : La communication interculturelle.
A.Colin. Paris.
SCHÜTZ, A.
(2003) : L’Etranger, suivie de : L’homme qui rentre
au pays. Allia. Paris
TODOROV, T.
(1988) : Nous et les autres. Seuil. Paris.Payot,
réédition 2001
________________
UE 91 Introduction au droit de la Propriété intellectuelle
M. Dominique Perdreau
La propriété
intellectuelle, terme générique pour désigner les
propriétés des créations immatérielles que sont la
propriété littéraire et artistique et la propriété
industrielle, est au cœur des enjeux sociaux et
économiques actuels. Stimulée par la révolution
technologique, elle donne lieu à des débats passionnés
dans le monde entier.
Le droit de
la propriété intellectuelle est l’encadrement juridique
de la création et de l’exploitation des objets
immatériels. Il comporte de nombreuses règles
spécifiques mais fait aussi appel à l’usage d’autres
disciplines juridiques, notamment le droit des contrats.
L’étude du
droit de la propriété intellectuelle est incontournable
pour qui se destine aux métiers de la culture. Matière
complexe, nous en proposerons une approche conceptuelle
et pratique, notamment à travers un aperçu de certains
contrats d’exploitation, afin de cerner les bases
indispensables à l’exercice de toute profession ayant à
connaître des créations intellectuelles.
Bibliographie
LUCAS A.,
Propriété Littéraire et Artistique,
Dalloz, Coll « Connaissance du Droit », 2004
BRUGUIERE J.-M.,
Droit des Propriétés Intellectuelles, Ellipses,
coll « Mise au Point », 2005
-Code de Propriété Intellectuelle
Pour aller plus loin :
CARON C.,
Droit d’auteur et droits voisins, Litec, 2006
LUCAS A. et H.-J.,
Traité de Propriété Littéraire et Artistique,
Litec, 2006
AZEMA J., et GALLOUX J.-C.,
Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, Coll
Précis Dalloz, 2006
PIOTRAUTJ.-L.,
Droit de la Propriété Intellectuelle, Ellipses,
Coll « Référence Droit », 2004
|












 27 décembre 2012
27 décembre 2012